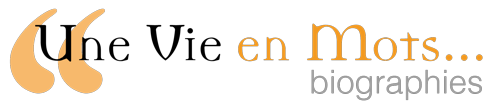Cortex Média, première plateforme de vidéos à la demande dédiée à la Santé, au Handicap et à l’Autonomie a initié un concours d’écriture en partenariat avec Cécile Mathias, animatrice d’ateliers d’écriture, sur le thème : raconter une histoire mettant en scène un enfant handicapé.
Découvrez ci-dessous le texte de la lauréate, Marie-Pierre Bourret, intitulé : « Jean sans cœur ».
Vous pouvez également le lire sur le blog de Cortex : https://www.cortex-media.fr/blog
Jean sans cœur
« Je suis né sans cœur. Oui, je sais, c’est difficile à croire et d’ailleurs, mes parents eux-mêmes ont pensé à une mauvaise plaisanterie quand on leur annonça : « Votre fils se porte à merveille, c’est un beau bébé, plein de vitalité, mais il est sans cœur ». Ma mère me serra dans ses bras et mon père me prit en photo, blotti contre les seins de ma mère, le sourire béat, les bras abandonnés à la plénitude. Sur l’une des photos, ma mère a la main posée sur mon petit buste, une grande main ornée d’une bague piquée de tous petits diamants, son visage marque un étonnement saisissant, sa bouche forme un O désemparé, ses yeux sont écarquillés comme deux soucoupes. Je crois bien que c’est à ce moment-là qu’elle s’est écrié: « Chéri, c’est vrai, je ne sens rien, notre petit Jean n’a pas de cœur ! » et que mon père a lâché son appareil photo acheté tout exprès à l’occasion de ma naissance, et s’est précipité à son tour vers moi pour chercher, en vain, un petit cœur battant sous ma barboteuse.
Dans les couloirs de la maternité, la nouvelle de ma naissance fit grand bruit et bientôt les spécialistes de la région s’agglutinèrent autour de mon berceau : on me tripota, on m’ausculta, me tournant, me retournant, on cherchait mon pouls partout, sur mon cou, sur mes pieds, à mes poignets, parfois même sur mon nez ou le bout de mes quelques cheveux, des fois qu’un petit glissement aurait décalé le précieux organe dans un lieu moins prévisible : rien n’y fit, je n’avais pas de cœur. A ce qu’on m’a raconté, je n’étais pas dépourvu de bonhomie, mes joues étaient rouges et rondes et je tétais avidement le lait de ma mère, je pleurais peu et même en voyant tous ces visages penchés au-dessus de moi. On prévint mes parents : « Votre fils vivra mais comme l’exigent les services de santé publique de notre pays, il sera suivi en maison spécialisée où on lui apprendra à vivre sans cœur ».
C’est ainsi que je me retrouvai à l’Institut des Trois Colombe, sans « s » à Colombe, affirmait le directeur, pour bien faire comprendre aux visiteurs qu’ici, on n’accueillait que les enfants à qui il manquait quelque chose. « Comme les Trois colombe à qui il manque un : s » radotait-il chaque fois qu’un nouveau pensionnaire se présentait. Normalement, les blagues sont faites pour faire rire mais celle-là ne faisait rire personne, surtout pas les parents qui arrivaient ici pour la première fois, leur enfant serré dans leur bras. D’ailleurs mon père éclata en sanglot en écoutant le directeur à qui il manquait aussi, il faut bien le dire, une bonne dose de délicatesse. Mais ce n’était pas une raison suffisante, plaisanta ma mère, pour enlever une lettre de plus à son écriteau, fait main par lui-même :« Institut des Trois Colombe », et dont il était si fier.
Je n’étais plus un bébé mais j’étais encore petit quand on m’installa dans l’aile ouest du bâtiment avec toute une ribambelle d’enfants à qui, comme moi, il manquait quelque chose ; certains ne voyaient pas, d’autres n’entendaient pas, d’autres encore ne pouvaient pas marcher ou se servir de leur mains, parfois les deux. Il y en avait qui se baladaient dans un drôle de monde, riant ou criant avec des êtres qu’eux-seuls semblaient rencontrer. Bref, nous étions tous bel et bien estampillés du label « Handicapé » ce qui nous donnait droit à des vacances gratuites à la mer chaque été et à la montagne chaque hiver.
Nous avions un moniteur qu’on appelait Zozo et que tout le monde aimait bien. Il était là tous les soirs et s’occupait de nous pour la toilette. Mais avant les douches, il criait : « Allez les enfants de l’Ouest, allons voir à quoi ressemble le couchant ce soir ! » Ils nous appelaient ainsi parce que nous logions dans l’aile ouest du bâtiment. Je crois que s’il avait travaillé avec les enfants de l’aile est, ils les aurait réveillés pour regarder l’aurore. Tout le monde adorait ce moment. On regardait par la fenêtre et jour après jour, on contemplait le ciel coloré. Quand il était encore bleuté, les enfants non-voyants disaient : « Le ciel est un peu froid ou le ciel souffle des nuages » et quand il était rougeoyant, ces mêmes enfants claironnaient : « Ca chauffe ou le ciel est en feu ! » mais surtout, tout le monde semblait heureux avec Zozo devant la grande fenêtre de l’aile ouest à parler à tort et à travers et à rire. Et puis le soir, au moment du coucher, c’était à qui resterait le plus longtemps dans les bras de Zozo pendant le câlin qu’il nous distribuait à chacun. Par habitude, je faisais comme les autres, je gigotais, je rigolais, je battais des mains et je m’agrippais à Zozo mais le cœur n’y était pas : au fond de moi, je ne sentais rien et la petite flamme qui brillait parfois dans les yeux des autres enfants, je ne la voyais pas dans les miens quand je me brossais les dents devant le miroir au-dessus du lavabo. J’avais des yeux bleu pâle, transparents comme du cristal que tout le monde remarquait en me voyant pour la première fois en s’exclamant : « Quels beaux yeux a ce petit Jean ! » mais très vite, je compris qu’il leur manquait quelque chose… Par exemple, lorsque Lili paraissait le matin, avec ses deux nattes brunes qui descendaient jusqu’à sa taille, je voyais bien que quelque chose se passait dans les yeux de mes copains, comment l’expliquer ? C’était comme si ces petits malins avaient le regard qui fondait comme une glace au soleil, dégoulinait le long du cornet, s’étalait sur leurs chaussures… Même Gus qui ne pouvait pas voir sentait que Lili était arrivée et attrapait doucement une de ses tresses qui glissait entre ses doigts, jusqu’à ce qu’elle reprenne sa place dans son dos… Quand Zozo prenait sa guitare, tous se mettaient à danser et Marthe qui se déplaçait uniquement en fauteuil écarquillait les yeux et la bouche et tout son visage semblait sorti d’une pluie d’étoiles filantes. Quand encore le directeur (nous l’appelions le Père Pancarte parce qu’il aimait beaucoup et souvent repeindre son écriteau « Institut des Trois Colombe ») entrait dans notre salle, chacun paraissait amusé, même content, comme si ce bonhomme avait le don de rassembler immédiatement toute une assemblée et de la faire rire sans qu’il n’ait prononcé une parole. Je ricanais avec les autres, sans trop savoir pourquoi, et comme tous les autres, je feignais de tenir une pancarte dans la main…
Comme mon cerveau fonctionnait plus vite qu’un ordinateur, il m’indiqua rapidement qu’être né sans cœur m’empêchait de connaître ce qui permettait aux autres d’être heureux ou même malheureux. Tout m’était égal : je n’avais pas d’envie, pas de peur, pas de peine et pas de joie. Je ne gênais personne et je faisais ce qu’on attendait de moi : rire quand il fallait rire ou me fâcher s’il y avait lieu de se fâcher (comme le jour où mon copain Bob souffla par la fenêtre toutes les bulles de la machine à bulles que ma grand-mère m’avait envoyée par la poste) ou pleurer s’il était bienvenu de pleurer (comme par exemple lorsque le petit chat de la femme du directeur fut écrasé par la pancarte du Centre, un jour de grand vent). Tout cela ne me posait aucun problème jusqu’au jour où arriva Mia, la nouvelle cuisinière de l’internat.
Mia était une dame souriante, un chignon relevé sur la tête, portant toujours des jupes et des corsages en dentelle sur lesquels elle nouait un tablier chaque jour différent : elle en avait pour tous les jours de la semaine, inscrits en grosses lettres : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche mais jamais le jour du tablier ne correspondait au jour du jour. Le directeur lui avait, dit-on, demandé d’accorder ses tabliers au jour ad hoc. Il croyait que ce petit désordre allait perturber ses pensionnaires mais il ne réussit jamais à lui faire entendre raison. Mia n’avait pas de temps pour choisir ses tabliers en quittant sa maison. En revanche, elle savait où trouver les meilleures fraises, juteuses, sucrées et cultivées sans engrais, elle courait ensuite à l’autre bout de la ville pour remplir son pot de verre d’une crème grasse et pas tout à fait blanche qu’elle fouetterait plus tard avec ardeur pour la faire monter en Chantilly plus solide qu’une meringue ! Bref, quand Mia arriva à l’Institut des Trois Colombe, la vie changea : à table, c’était une fête tous les jours, elle préférait qu’on n’affichât pas le menu, aimant faire des surprises et s’amusant à observer les visages des uns et des autres. C’est ainsi qu’elle connut rapidement les goûts et les dégoûts de chacun et quand un plat ne plaisait pas à l’un de nous, elle lui taillait une bonne tranche de pain au levain, la lui grillait, la frottait à l’ail avec un filet d’huile d’olive et lui chantonnait qu’il mangerait mieux demain. Le directeur tenta de la persuader qu’il eût été préférable qu’elle ne mît point d’ail sur le pain, mais à la place une cuillère de confiture ou un peu de beurre, mais elle n’en faisait qu’à sa tête et lui expliquait avec moult détails que sa tartine constituait un repas complet au temps de ses arrières-arrières-grands-parents, producteurs d’olive en Provence il y a un siècle. En général, le directeur abandonnait car Mia était un tourbillon virevoltant du matin au soir et il eut fallu se lever de bonne heure pour lui résister.
Si je vous parle de Mia, c’est que ce fut la première personne qui s’aperçut que quelque chose clochait en moi. Chacun savait que je n’avais pas de cœur et que j’étais là pour cette raison, mais Mia remarqua que malgré ma bonne santé et ma vigoureuse vitalité, il n’y avait jamais d’étoiles dans mes yeux ou de fraîches cascades de rire dans ma gorge. Bien sûr elle ne le dit pas ainsi, mais moi c’est un peu ce que j’ai entendu. « Je vous assure, clamait-elle au directeur et à toute l’équipe du Centre, j’ai vu des enfants qui ne pouvaient pas marcher, ni voir, ni entendre, ni se tenir tranquille, j’en ai vu rester dans un coin, se balancer sur une jambe et sur l’autre toute la journée mais c’est la première fois que je vois un enfant qui reste de marbre quand j’apporte mes fraises à la crème, ou mes gâteaux au chocolat ou mes frites maison ou… ». Car voyez-vous, ce qu’elle ne disait pas, c’est qu’elle mettait dans toutes ses préparations un ingrédient à côté duquel personne ne pouvait passer, un ingrédient qui ne manquait jamais dans son panier ou dans ses placards, un ingrédient qu’elle promenait partout avec elle et dont elle inondait tous ses plats : Mia mettait de l’amour dans sa cuisine et même l’ail puant sur la tartine grillé ne parvenait pas à cacher les saveurs de l’amour de Mia ! Tout le monde en avait sa part et le cœur réchauffé, malgré tous les handicaps qui rendaient notre vie parfois difficile. Tout le monde, sauf moi. Sans cœur, je ne sentais ni le chaud ni le froid, ni le tendre ni le dur, ni le joyeux ni le triste… je me mis à envier mes petits camarades dont les yeux s’éclairaient ou pleuraient, dont la bouche riait ou criait, dont les mains applaudissaient ou cognaient, dont le cœur aimait ou se serrait… Je pouvais courir mais sans connaître les joies de me défouler dans l’herbe, je pouvais voir mais sans que jamais rien ne me ravisse, je pouvais entendre mais ce qui entrait par une oreille ressortait par l’autre sans laisser de trace, je pouvais comprendre des équations très difficiles mais mes trouvailles me laissaient froid comme la pierre. Je réalisai peu à peu qu’il me manquait vraiment quelque chose d’important. Bien sûr, je savais que j’étais né sans cœur mais comme je n’en avais jamais porté, j’ignorais à quoi il pouvait bien servir. Les yeux de Mia qui me regardaient plein tendresse me donnèrent une idée de ce qu’était la vie quand on a du cœur et je commençais à ressentir, je ne sais trop comment puisque je n’avais pas de cœur, pour la première fois, une pointe de tristesse. Quelque chose comme un picotement à l’intérieur, un peu doux, un peu mouillé, pas douloureux, une sensation comme un papier qui se déchire lentement sans qu’on ne puisse y faire quoi que ce soit. Ce fut mon premier sentiment et aussi mon premier moment de joie. Ainsi, on pouvait aussi vivre à l’intérieur de soi, ressentir, vibrer, exister ! Ainsi il existait un monde invisible! J’étais Jean, né sans cœur, et Mia avait réussi à faire palpiter l’endroit de mon cœur absent, juste pour que je sois content de manger ses fraises Chantilly ou que j’aie envie de son gâteau au chocolat !
Alors je commençai à percevoir ce qui se passait dans la vie de mes camarades et qui n’avait jamais existé dans la mienne : tout ce qui nous entoure, les gens, les choses, les couchers de soleils vient se loger dans le cœur des gens et y laisser une empreinte, un souffle, parfois un coup de tonnerre qui ne se voit pas mais qui éclaire ou assombrit les yeux ! Et je compris que tous ces enfants à qui il manquait quelque chose et qu’on avait placé à l’Institut des Trois Colombe pour cette raison pouvaient quand même recevoir tous ces éclats de vie et en faire quelque chose de merveilleux comme aimer, pleurer, rire, être triste ou joyeux de tout leur cœur ! Et moi qui n’avais pas leur handicap, j’étais incapable de tout cela et je restais sans sentiment, éternellement le même, d’humeur égale avec un grand blanc à l’intérieur de moi, comme un morceau de sucre en poudre durci par les années et dont on ne peut rien faire !
Mia n’écoutait pas le directeur mais le directeur ne l’écouta pas non plus. Par précaution, il fit quand même déplacer une psychologue très gentille qui me fit faire beaucoup de tests et me montrait des images entre lesquelles je devais choisir celle que je préférais, et dire pourquoi je l’avais choisie. En réalité, je piochais en m’amusant à faire de petits calculs mathématiques très rapides et je répondais que les chiffres avaient choisi pour moi. Pourtant une image attira mon attention : c’était une Bretonne avec un joli tablier brodé qui portait une coiffe de dentelle et tenait à la main une grande poêle dans laquelle elle faisait sauter une crêpe. Mes calculs mathématiques furent pris de court et je choisis cette image sans hésiter. La psychologue n’y vit que du feu mais moi je sentis que quelque chose se passait, là, dans ma poitrine. Ca coulait comme le sable d’un sablier, comme le sucre d’un sucrier, comme la farine dans le tamis, comme l’eau du robinet, ça chatouillait et je crois que je reçus là mon premier plaisir. Et ce plaisir se frayait un chemin en moi, se glissa dans mes pensées et s’arrêta devant le visage de Mia, posé dans ma mémoire. Et cette image redoubla le plaisir que je ressentais. Il retourna tranquillement finir sa course dans ma poitrine où il s’endormit comme un faon dans l’herbe haute, laissant la trace de son passage.
Et toi, amie, ami qui me lit, as-tu un cœur, un petit cœur toujours battant parfois tremblant, parfois vibrant, parfois brûlant ?
Oui ? Alors prends-en bien soin, car il peut faire des miracles, voici la fin de mon récit :
Une nuit, je fus réveillé en sursaut : dans mon rêve quelqu’un frappait à ma porte, je me précipitais pour aller ouvrir mais une fois la porte ouverte, je ne voyais personne et on continuait à toquer, personne à droite, personne à gauche mais toujours ce petit bruit régulier qui ne cessait pas… Puis j’entendis ce bruit enfler, devenir plus fort qu’un gong et l’un des sons me réveilla tout à fait. J’étais en nage, assis dans mon lit et je perçus, là, dans ma poitrine comme un cheval au galop qui tapait qui tapait, puis au trot tout bondissant puis peu à peu au pas marchant tranquillement, sans s’arrêter, sans jamais s’arrêter, totoc, totoc, totoc…
Une fois de plus, la nouvelle fit grand bruit : « Jean sans cœur a un cœur ! Jean sans cœur a un cœur ! Jean sans cœur a un cœur ! ». Une fois de plus, tous les spécialistes affluèrent, me tripotèrent, m’auscultèrent, me prirent le pouls : « Même au bout des doigts ! Même sur les gros orteils ! On sent son pouls jusqu’à la pointe des cheveux! Sur la pointe de la langue ! »
Le directeur marmonnait : « On ne pourra pas le garder, il ne lui manque plus rien ! », sa femme haussait les yeux au ciel en souriant gentiment : « Ne manquerais-tu pas d’un peu de fantaisie mon chéri ? » et comme le directeur n’était pas un mauvais bougre, il répondit : « Peut-être ! Mais au moins que l’on enlève un bouton à sa chemise ! ».
Pendant ce temps, une odeur exquise planait dans tout le bâtiment, emplissant tous les couloirs et pénétrant dans le réfectoire et les chambres : Mia faisait cuire un délicieux gâteau au chocolat, plein de beurre, de cacao et d’amour. »